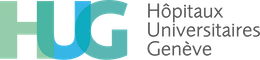Violence symbolique et institutionnelle dans les pratiques de soins

Article rédigé par Jessica Héritier, sociologue, assistante de recherche, UIMPV.
La violence symbolique est le concept fondamental de la sociologie de Pierre Bourdieu utilisé pour analyser la reproduction sociale et les rapports de domination (classe, genre, race) comme éléments de structuration de l’ordre social à travers l’intériorisation des hiérarchies et des normes systémiques. Par définition, « la violence symbolique est cette coercition qui ne s’institue que par l’intermédiaire de l’adhésion que le dominé ne peut manquer d’accorder au dominant (donc à la domination) lorsqu’il ne dispose, pour le penser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui, que d’instruments de connaissance qu’il a avec lui et qui, n’étant que la forme incorporée de la structure de la relation de domination, font apparaître cette relation comme naturelle »[1]. Associée à la violence structurelle ou violence institutionnelle, la violence symbolique est une forme de violence psychologique invisible, issue d’un processus inconscient et complexe d’incorporation et de reproduction des catégories de classement.
Véritable outil de détection et de compréhension des logiques de domination, la violence symbolique vient questionner les principes d’égalité et d’inclusivité au sein des systèmes de pouvoir en apportant une réflexion critique sur la légitimité des savoirs et des pratiques, des privilèges et des places qu’occupent les individus dans la hiérarchie sociale.
La violence symbolique est particulièrement utile dans le cadre institutionnel où l’on observe des rapports asymétriques entre professionnel.le.s, usagers.ères, membres de l’institution et employé.e.s. Fondée sur la validation d’une hiérarchie considérée comme légitime, la violence institutionnelle est le résultat des dysfonctionnements à l’œuvre dans la sphère plus large de la structure politique et sociale. Elle implique également des dynamiques de groupe qui concourent à maintenir et reproduire les violences par différentes formes de discriminations.
Il existe donc un lien étroit entre les pratiques professionnelles, l’organisation des institutions et la structure sociale plus large. Ainsi, nous ne pouvons questionner les pratiques professionnelles et institutionnelles sans prendre en considération les logiques sociales et culturelles qui les régulent, les positions des acteurs.rices sociaux.ales au sein des structures de pouvoir, de même que le poids des représentations que ce système contribue à procréer. Agisme, sexisme, racisme, classisme, validisme, hétérosexisme, capacitisme sont des exemples des systèmes d’oppression et d’inégalité au cœur des rapports de pouvoir qui maintiennent et perpétuent les discriminations. Pour lutter contre la violence institutionnelle et les discriminations, il est alors important de prendre conscience de ces mécanismes mais aussi d’adopter une attitude autoréflexive sur ses propres pratiques et les représentations qu’elles induisent avec l’idée que les savoirs sont situés[2] et que « le privé est politique »[3].
Dans les pratiques professionnelles, la violence symbolique se manifeste par la parole, les gestes, les comportements qui cherchent à exclure, stigmatiser et catégoriser par le biais de normes de discrimination. De ce point de vue, les structures langagières sont un bon outil d’analyse des biais cognitifs, ainsi que des représentations et stéréotypes qui soutiennent les logiques de domination des populations à charge. En effet, comme le décrit Pierre Bourdieu, la violence symbolique est une « violence douce, insensible, invisible pour ses victimes mêmes, qui s’exerce pour l’essentiel par les voies purement symboliques de la communication et de la connaissance »[4]. Par conséquent, « les rapports de communication par excellence que sont les échanges linguistiques sont aussi des rapports de pouvoir symbolique où s’actualisent les rapports de force entre les locuteurs ou leurs groupes respectifs »[5]. Violence cachée, la violence symbolique opère donc « prioritairement dans et par le langage, et plus généralement dans et par la représentation »[6]. Le langage est donc vecteur des représentations, qui ne sont jamais individuelles mais toujours construites de manière collectives, induites par les normes sociales, culturelles et institutionnelles. Il est à la fois un marqueur d’intégration et d’identification, d’exclusion et de différenciation, aboutissant à une discrimination positive ou négative. Chez les soignants, le langage va servir à « étiqueter négativement les patients qui dévient d’une certaine norme, ne légitiment pas l’efficacité de leurs interventions thérapeutiques ou génèrent de la frustration. Il soutient les jugements moraux et les biais implicites liés à un ensemble de facteurs individuels et organisationnels »[7].
En tant que soignant, il est alors nécessaire d’adopter une posture éthique et de reconnaitre que la neutralité bienveillante n’est pas possible. Cela s’observe particulièrement dans la clinique de l’Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence (UIMPV) où les violences « impliquent un parti pris inscrit dans le contexte sociétal [car] la violence en actes a valeur de communication ; ce langage comportemental est un message imprécis pouvant donner lieu à de multiples interprétations et projections. Il est [donc] indispensable pour le décoder de le contextualiser »[8].
Les usagers.ères qui consultent les structures de soins sont particulièrement concerné.e.s par cette problématique du fait de leur état de santé, situation ou statut social qui les rendent plus ou moins vulnérables ou dépendant.e.s des services d’aide et d’accompagnement. Dans ce contexte, il vaut la peine de s’interroger en tant que professionnel.l.e sur l’usage et la fonction du langage qui peut être tout autant inclusif que stigmatisant, avec des conséquences sur la qualité de la prise en charge. En effet, si la personne usagère des soins « a perçu la frustration du médecin ou a été insatisfaite de la qualité de la communication, cela peut la dissuader d’adhérer aux recommandations thérapeutiques, renforçant encore la vision négative du médecin (effet Pygmalion) »[9]. Dès lors, il est nécessaire d’utiliser une terminologie non stigmatisante qui n’identifie pas la personne à sa maladie ou à son trouble. Comme l’évoque une étude sur le sujet à propos des personnes avec un syndrome de dépendance « le langage centré sur la personne permet ainsi de ne pas la considérer comme un problème en soi mais plutôt comme présentant un problème. Cette subtile différenciation terminologique rejette également toute idée que la personne qui présente un trouble ou une caractéristique comportementale puisse en être responsable et, de facto, en être même considérée comme coupable »[10]. Cette vision est au cœur de la clinique du réel de l’Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence (UIMPV) qui privilégie une approche globale, nuancée et inclusive de la violence intégrant les contextes transgénérationnel, environnemental et sociétal. Ainsi, les patient.e.s sont considéré.e.s comme des personnes confrontées à une situation de violence avant d’être des auteur.e.s ou des victimes de violence.
Cette réflexion sur la terminologie questionne également la validité du champ sémantique de certaines disciplines, utilisé pour décrire les usager.ères et leurs troubles. A ce propos, les psychologues féministes remettent en question « certaines catégories diagnostiques psychiatriques du DSM qui pathologisent l’expérience des femmes [et] les lectures biologisantes de la violence masculine formulées par la psychologie évolutionniste »[11]. En outre, elles affirment que le discours « n’aura pas la même portée, en tant que psychologue femme cisgenre blanche valide, si on l’adresse à une personne racisée, perçue comme non blanche, trans, porteuse de handicap »[12]. Le langage peut donc viser les minorités et les populations marginalisées en renforçant les discriminations, parfois intersectionnelles, dont elles sont la cible. La discrimination peut aussi s’exercer par un déni du langage en invalidant les propos de l’usager.ères des soins. C’est par exemple le cas du « mégenrage » à l’encontre des personnes lgbtqia+ qui consiste à nier les critères relatifs à leurs identités de genre en refusant d’utiliser le pronom, le nom ou d’autres termes qu’elles ont choisi pour se désigner.
Dans un but d’éthique et d’amélioration des soins, les professionnel.le.s de la santé mériteraient alors d’être in-formé.e.s à ce sujet car « le choix des mots influence directement notre perception, jugement et attitude, tout comme ceux de nos collègues qui entendent ces mots ou les lisent. L’impact terminologique est donc essentiel pour prévenir les discriminations et promouvoir un traitement équitable (…) [puisque] les mots véhiculent des images, des valeurs et représentations puissantes, qui conditionnent notre attitude et notre comportement. (…) Le rayonnement des mots, son impact et l’intention dépassent donc largement notre conscience, s’étendant aussi bien aux personnes en traitement qu’aux soignants et à notre société »[13]. De plus, il serait nécessaire de « privilégier un processus d’individualisation plutôt que celui de catégorisation. Autrement dit, de modifier notre préjugement pour contrer les biais (…) [car] une pratique médicale prenant en compte l’existence des biais ainsi que les besoins de chaque sous-population est indispensable pour obtenir une équité des soins. Cette conscientisation des pensées automatiques liées aux biais implicites aura également un impact positif sur des attitudes sexistes ou racistes ou sur des comportements de type harcèlement sexuel dans des contextes professionnels au sein d’une institution »[14]. Dans cette perspective, une réflexion sur les discriminations à l’égard des usagers.ères dans les systèmes de soins ne peut se passer d’une déconstruction des savoirs et des pratiques reposant sur une approche féministe, intersectionnelle et située des violences symboliques à l’œuvre dans les institutions socio-médicales.
Bibliographie
AMY, M., MATEUS, S., D., DOMINICÉ-DAO, M., LUCIA, S., D. (2021), « Biais dans la consultation : quels outils pour le·la clinicien·ne ? », Rev Med Suisse, 17, no. 752, 1649–1653.
BOURDIEU Pierre (1982), « Ce que parler veut dire. Économie des échanges linguistiques », Fayard, Paris.
BOURDIEU Pierre (1998), « La Domination masculine », Seuil, Paris.
BOURDIEU Pierre (1997), « Méditations pascaliennes », Liber. Seuil, Paris.
DOMINICÉ DAO, Melissa et BODENMANN, Patrick (2022), Chapitre 1.8 « Ce que l’autre peut susciter chez nous : préjugés, stéréotypes et discrimination dans la pratique clinique » in : BODENMANN, Patrick, JACKSON, Yves, VU, Francis et WOLFF, Hans, Vulnérabilités, diversités et équité en santé. Genève : Médecine & Hygiène. Hors collection, p.95-101.
FONTE, David et LELAURAIN, Solveig (2024), « Épistémologies féministes et psychologie Savoirs situés, pratiques situées », Paris : Hermann, « Psychanalyse en questions ».
GEROUDET Ronald et VISTOLI Marion (2023), « Ce que penser le genre vient révéler dans la psychothérapie », Rhizome, N° 85(2).
GIRARD, J., RINALDI BAUD, I., REY HANSON, H. et POUJOULY, M. (2004), « Les violences conjugales : pour une clinique du réel », Thérapie Familiale, Vol. 25(4), 473-483.
HANISCH Carol (1969), « The Personal Is Political » in Notes from the Second Year : Women’s Liberation.
HARAWAY Donna (1988), « Situated knowledge. The science question in feminism as a site of discourse on the privilege of partial perspective », Feminist Studies, 14(3), 575-599.
LIDSKY-HAZIZA, Déborah., et al. (2022) « Chapitre 1.21. L’impact des mots pour diminuer le stigma des troubles liés à l’utilisation de substances » in Vulnérabilités, diversités et équité en santé, Médecine & Hygiène, p.229-238.
TERRAY Emmanuel (1996), « Réflexions sur la violence symbolique », Actuel Marx, n° 20, Autour de Pierre Bourdieu, PUF, Paris.
[1] BOURDIEU, 1997, p.204
[2] HARAWAY Donna
[3] HANISCH Carol
[4] BOURDIEU, 1998, p. 7
[5] BOURDIEU, 1982, p. 14
[6] TERRAY, p. 11-25
[7] DOMINICÉ DAO et al., p.99
[8] GIRARD et al., p.475, 476
[9] DOMINICÉ DAO et al., p.100
[10] LIDSKY-HAZIZA et al., p.232
[11] FONTE et al., p.9,10
[12] GEROUDET et al., p.9
[13] LIDSKY-HAZIZA et al., p.233, 235
[14] AMY et al., p.1652-1653